 |
||||
 |
||||
|
||||
 |
Patrimoine de Skikda - Page 1 - Patrimoine multiple |
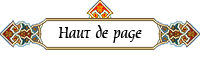
|
 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||


— Mosaïque —
LE PATRIMOINE DE SKIKDA - Page 2 -
– Patrimoine oublié, dispersé, pillé –

Patrimoine national et patrimoine de Skikda
![]() ette page est consacrée au patrimoine dispersé de Skikda et pour rappeler que de nombreux éléments archéologiques sont encore dans la nature, que d'autres ont été emportés en France. On peut espérer que ces pièces seront rendues à l'Algérie pour être restituées à Skikda car elle font partie de son patrimoine et de son passé. Les textes qui font références à ces différents éléments sont rapportés avec la source qui les cite. Il va de soi que cette liste n'est pas exhaustive.
ette page est consacrée au patrimoine dispersé de Skikda et pour rappeler que de nombreux éléments archéologiques sont encore dans la nature, que d'autres ont été emportés en France. On peut espérer que ces pièces seront rendues à l'Algérie pour être restituées à Skikda car elle font partie de son patrimoine et de son passé. Les textes qui font références à ces différents éléments sont rapportés avec la source qui les cite. Il va de soi que cette liste n'est pas exhaustive.
Il
reste à l’Algérie de demander et d’obtenir la restitution de tous ses biens patrimoniaux qui ont été emportés en France dès la conquête en 1830. Il est immoral qu'un pays, quel qu'il soit, puisse faire la sourde oreille à une demande aussi légitime, et entériné tout simplement un vol. D'ailleurs, en 2010 la Chine a obtenu de la France la restitution d'objets faisant partie de son patrimoine.
Ces biens patrimoniaux volés, qui sont parties intégrantes de l’Histoire du pays, se décomposent en :
- archives (nationales et appartenant à des particuliers)
- objets de toutes sortes pris lors des pillages des différentes villes algériennes
- pièces archéologiques emportées soit dans les musées français soit chez des particuliers.
- etc.
Rappel non exhaustif d'une partie du patrimoine
A en juger par les nombreux édifices romains de la ville, Skikda devrait posséder une des plus riches collections archéologiques d'Algérie. Malheureusement, en 1843, un vaisseau de l'Etat transporta en France plusieurs monuments de l'ancienne Numidie, parmi lesquels figuraient 48 stèles épigraphiques et une certaine quantité de sculptures provenant de Rusicade. On préparait alors la création d'un musée algérien au Louvre à Paris.
Source : Annuaire de la Société archéologique - p256 et suivantes (288).pdf
Source : Annuaire de la Société archéologique - p230 et suivantes (248).pdf

Dans la falaise du Djebel Skikda on a découvert des caveaux puniques. L'un deux contenait six têtes de lion en bronze.

En 1852, M. l'Abbé Plasson qui inaugurait l'église et y installait le tableau donné à la cité par Mgr Dupuch, représentant l'ensevelissement du Christ d'après Van Dyck.

En mai 1849, M. Belliard écrira (Souvenirs d'un voyage en Algérie - Paris 1854 - Le mont Filfila et ses carrières de marbre) :
"A Philippeville, on découvre très souvent de précieux restes de l'art Romain. Un de mes amis m'a raconté qu'en 1844, se trouvant dans une rue, il vit des ouvriers paveurs, retirer à quelques décimètres de la terre, deux statues de grandes dimensions assez bien conservées. Ces statues sont aujourd'hui au musée d'Alger."

Rusicade, ville considérable pour l'époque romaine, avait, autour de ses murs, des nécropoles importantes.
Une petite partie seule a été prospectée, au hasard des constructions modernes.
Le sous-sol est donc riche en souvenirs archéologiques, qui sont à jamais perdus car des immeubles importants sont bâtis sur eux.
C'est ainsi qu'un grand cimetière se trouvait derrière la Caserne Mangin, du 15ème régiment de Tirailleurs Sénégalais, et le Parc à fourrage de la garnison.
Des tombeaux intéressants ont été découverts et les sarcophages transportés au Musée de la ville.
Un autre cimetière s'étendait à l'Est de la caserne, à 150 m au Sud. On y a mis à jour les ruines d'un colombaire.
Le faubourg de l'Espérance, plus au Sud encore, était une vaste nécropole qui s'étalait sur les flancs du Mamelon Négrier. Dans la propriété Crespin, se trouve encore une grande salle avec des niches pour les sarcophages.
Dans la propriété Œttly, les vestiges d'une villa, avec thermes et cuves, se voient également.
Un peu plus bas, une belle mosaïque romaine n'avait pu être enlevée, il y a cinquante ans. Elle est enterrée sous deux mètres d'humus et une orangerie a été créée, la recouvrant pour un temps indéterminé. Il est bon d'en mentionner ici l'existence pour l'avenir.

§ II. - Monuments funéraires. N° 7
| DIS MANIB CAECILIAE NIGELLINAE CAECILI GALLI FLAMIN PROVIN CIAE . FILIAE |
"Dis manibus Caeciliae Nigellinae, Caecili Galli, flaminis provinciae, filiae".
"Aux dieux mânes de Cécilia Nigellina, fille de Cecilius Gallus, flamine de la province."
Sur une stèle brisée par le bas.
Nigellina était fille d'un des premiers fonctionnaires de Rusicade, qui fit bâtir à ses frais, dans cette ville, un tribunal et des rostres, ainsi que l'atteste une grande pierre trouvée sur l'emplacement du Forum et transportée au Musée du Louvre, en 1843. Sur la face principale de ce monument, sont énumérés les titres et les fonctions de Cecilius.
Voici l'inscription ; telle qu'empruntée au Recueil de M. Léon Renier (Inscriptions romaines de l’Algérie – n° 2169) :
Caius Caecilius, Quinti filius, Galeria tribu, Gallus, habens equum publicum, aedilis habens juris dictionem quaestoris pro praetore, praefectus pro triumviro quater, praefectus fabrum consularis bis et praetorii bis, habens ornamenta quinquennalicia decreto decurionum, exe quinque decuriis, decuriarum trium, quinquennalis, praefectus juri dicundo Rusicadi, flamen divi Julii,
Nomine suo et Proximiae, Marci filiae, Proculae, uxoris Suae, et filiorum Gallae et Galli et Coruncaniae et Nigellinae, tribunal et rostra sua pecunia facienda curavit.
On remarquera que l'épitaphe porte "flamen provinciae" tandis que l'autre document écrit "flamen divi Julii".

![]() ans certaines provinces de l'empire romain et dans les trois provinces d'Afrique, ainsi que nous l'ont appris un grand nombre d'inscriptions, de même qu'une lettre de Pline le Jeune adressée à l'empereur Trajan, les citoyens élevés aux magistratures municipales payaient cet honneur en versant dans la caisse de la ville une certaine somme appelée honorarium, honoraria summa ou summa legitima.
ans certaines provinces de l'empire romain et dans les trois provinces d'Afrique, ainsi que nous l'ont appris un grand nombre d'inscriptions, de même qu'une lettre de Pline le Jeune adressée à l'empereur Trajan, les citoyens élevés aux magistratures municipales payaient cet honneur en versant dans la caisse de la ville une certaine somme appelée honorarium, honoraria summa ou summa legitima.
Quand on se contentait de s'acquitter de cette obligation, tout était dit, et il n’en était plus question ; mais souvent il arrivait que, lors des élections, un candidat, pour remporter sur ses compétiteurs, promettait, outre la somme honoraire, un monument, une représentation théâtrale, un repas public, ou même une distribution d'argent ; et alors, s'il était élu, on lui permettait de faire graver, sur le monument qu'il avait promis de faire élever à ses frais, une inscription destinée à perpétuer le souvenir de sa libéralité.
C'est à cet usage que nous devons la plupart des inscriptions municipales qui ont été recueillies dans l'ancienne Numidie ; il explique le grand nombre de monuments que l'on rencontre dans les ruines des villes, même les moins considérables de cette province, et peut servir à déterminer, avec une certaine approximation, la richesse relative de ces différentes villes, car il est naturel de supposer que l’on avait eu égard à cet élément pour fixer la somme honoraire, dont l'importance varie avec les localités. (Dans la lettre de Pline le Jeune, citée plus haut, il est question des moyens de coercition que les villes employaient contre les magistrats qui tardaient trop à payer la somme honoraire).
Léon Renier, bibliothécaire à la Sorbonne, chargé d’une mission en 1852 pour rechercher les monuments épigraphiques, rapporte dans une lettre du 17 décembre 1852, que des fouilles considérables, entreprises pour la construction d'un théâtre, sur l'emplacement du forum de l'antique Rusicade, avaient mis au jour les substructions d'une magnifique basilique. Outre un nombre assez considérable de débris d'architecture d'une grande richesse, on y avait découvert l'inscription suivante, qui contient une date consulaire et offre d'ailleurs un certain intérêt. Elle est gravée, en très beaux caractères, sur les deux faces opposées d'un piédestal en marbre blanc. On lit :
| Sur la face principale | Sur la face opposée |
| M.FABIVS FRONTO AVGVR PI D CVM LV DIS SCAENICIS DE DIT PRAETER DE NA RIOS MILLE AD OPVS THEATRI N FILI SVI SENECIO NIS |
POLLICITVS |
| Cette inscription doit se lire ainsi : Marcus Fabius Fronto augur, praefectus, juri dicundo, cum lu dis scaenicis de dit, praeter dena rios mille ad opus theatri, nomine filii sui Senecio nis |
Cette inscription doit se lire ainsi : Pollicitus Fusco II et Dex tro consilibus, tertio nonas januarias dedicavit iisdem consulibus, pridie Kalendus apriles |
Il règne une grande incertitude sur les noms des deux consuls qui sont mentionnés sur notre monument ; mais on est d'accord sur la date de leur consulat, qui répond à l'année 225 de notre ère, ou à la quatrième du règne d'Alexandre Sévère. Ainsi Marcus Fabius Fronto s'était engagé, le 3 janvier 225, à élever ce monument, et il le dédia le 31 mars suivant, c'est-à-dire moins de trois mois après son élection. On s'explique pourquoi il a indiqué ces deux dates dans son inscription ; c'est qu'il arrivait souvent que les magistrats, une fois élus grâce aux brillantes promesses qu'ils avaient faites aux décurions, se montrent ensuite fort peu empressés de s'acquitter des engagements qu'ils avaient ainsi contractés.
S'il arrivait que des personnages meurent sans avoir tenu les promesses qu'ils avaient faites dans de semblables circonstances, ce sont leurs héritiers qui étaient obligés de les tenir pour eux. On conçoit que si une pareille négligence devait mécontenter les habitants, l'empressement dont l'auteur de notre monument avait fait preuve dut être, au contraire fort agréable aux habitants de Rusicade, et l'on ne s'étonnera pas qu'on l’ait autorisé à en perpétuer le souvenir en même temps que celui de ses libéralités.
Cet empressement, du reste, n'était pas sans exemple à Rusicade ; sur un fragment de piédestal trouvé en 1850, et qui faisait encore partie de la petite, mais intéressante collection de monuments formée dans l'enceinte de son théâtre antique, on pouvait lire :
| Sur une face | Sur la face opposée |
POLLIC . III.NON . IANVARIAS |
DEDIC.III.NON. MART |
| Cette inscription doit se lire ainsi : Pollicitus tertio nonas januarias |
Cette inscription doit se lire ainsi : Dedicavit tertio nonas martias |
Le consulat de Sabinianus et de Seleucus correspond à l’année 221. On voit que le magistrat qui a fait élever le monument auquel a appartenu ce fragment avait montré plus d'empressement encore que Marcus Fabius Fronto à s'acquitter de ses engagements, puisque deux mois seulement séparent la date de sa promesse de celle de la dédicace de ce monument.
Considérées d'un autre point de vue, ces deux inscriptions ont une très grande importance historique ; car elles sont la démonstration la plus évidente d'un fait que l'on n'avait jusqu'ici conclu que par induction, à savoir que le renouvellement des magistrats annuel avait lieu, dans les colonies, comme à Rome, le 3 des nones de janvier.
Marcus Fabius Fronto ayant rempli à Rusicade les doubles fonctions d'augure et de juge, on peut se demander pour laquelle de ces deux fonctions il avait fait élever le monument dont il s'agit, et quel était ce monument.
L'inscription suivante, qui a été gravée par les ordres du même personnage, à l'occasion du même événement, et qui était inexplicable avant la découverte de celle qui a donné lieu à cette digression, a permis de répondre à ces deux questions :

(Cette inscription, qui fait partie de la Galerie Africaine du Musée du Louvre, a été découverte par M. Delamare dans les ruines du théâtre de Rusicade. Ce savant officier l'a fait graver dans son "Archéologie de l’Algérie", pl. 29, n° 7.)
La troisième ligne de cette inscription, qui peut maintenant être rétablie avec certitude, donne sa longueur primitive et a fourni ainsi un moyen de la restituer. Voici ce qu'on devait y lire lorsqu'elle était entière :
M.FABIVS.L.FIL.QVIR.F(R)ON(TO).AVGVR.(PRAEF.I.D.LVDOS.SCAENICOS.OB) HONOREM.PRAE(F.ET.) IMP.(CAES.M.) A(VR.SEVERI.ALEXANDRI. AVG.STATVAM DEDIT.PRAETER.OBLATIONEM.DEN(ARIORVM.MILLE.NOMINE)
FILI.SVI .SENECIONIS.AD.CVLTVM.THEA(TRI.DECRETO.DECVRIONVM)
A lire ainsi :
Marcus Fabius, Lucii filius, Quirina tribu, Fronto, praefectus juri dicundo, ludos scaenicos ob
honorem praefecturae et imperatoris Caesaris Marci Aurelii Severi Alexandri Augusti statuam
dedit, praeter oblationem denariorum mille, nomine
filii sui Senecionis, ad cultum theatri, decreto decurionum.
On voit que Marcus Fabius Fronto, dont cette inscription nous fait connaître, d'ailleurs, la filiation et la tribu, avait fait élever le monument dont il s'agit, à l'occasion de sa nomination aux fonctions de juge à Rusicade, et que ce monument était une statue de l'empereur Alexandre Sévère, dont le nom a été effacé ici, comme dans beaucoup d'inscription de l'ancienne Numidie probablement par les ordres de Capellien, lieutenant de l'empereur Maximin dans cette province. Le piédestal, en marbre blanc, sur lequel figurait la première inscription devait supporter cette statue, qui ornait probablement le forum de la colonie. C'est, en effet, sur l'emplacement du forum qu'il a été trouvé.
Quant à l'inscription destinée à rappeler les jeu scéniques donnés par M. Fabius Fronto, et surtout l'offrande de mille deniers qu'il avait faite, au nom de son fils, pour l'ornement du théâtre, elle devait être encastrée dans les murs de cet édifice et c'est là aussi qu'elle a été découverte.
![]()
Rusicade est attestée comme colonie romaine par plusieurs monuments épigraphiques découverts sur les lieux, comme par exemple cette inscription retrouvée, en 1841, sur une stèle en marbre du Théâtre Romain et reproduite ci-dessous.
Cette inscription est sur un très beau marbre qui paraît avoir servi de piédestal à une statue. L'écriture d'une bonne époque, est renfermée dans un simple encadrement de bon goût.
Le marbre qui porte cette inscription est haut de 1,25 m sur 0,85 m de large.
Les lettres de la 1ère et de la dernière lignes sont hautes de 0,46 m, toutes les autres lettres mesurent 0,34 m de haut.
Cette pièce archéologique, comme tant d'autres, sera emportée en France et fera partie des collections du Musée du Louvre.
M. de Clarac a pu relever sur le monument même l'inscription qu'il a fait reproduire dans la planche LXXXIII (83) du tome II de sa publication "Musée de sculpture antique et moderne". L'inscription est reproduite dans la planche LXXXIII (83) du même ouvrage.et commentée pages 1312 et suivantes.
Inscription reproduite dans l'ouvrage "Archéologie de l'Algérie" de ccc, planche XXX.
.M. Léon Renier a donné cette même inscription, sous le n° 2174 de son recueil des "Inscriptions romaines de l'Algérie".
Dans les documents que j'ai consultés, j'ai trouvé une différence dans le texte retranscrit (texte en bleu) à partir de la stèle. Je me contente de les exposer sur ce site, cette différence de relevé ne change rien sur le fond.

— Skikda - Reproduction de la stèle en marbre retrouvée dans le théâtre de Rusicade —
| 1ère transcription Source Pl. LXXXIII - n° 98 |
2ème transcription |
| GENIO COLONIAE VENERIAE RVSICADIS AVG.SACR. M. AEMILIVS BALLATOR PRAETERIS-X-M-N QVAE IN OPVS CVLTVMVE THEATR POSTVLANTE POPVLO DE DIT STATVAS DVAS GENI VM PATRIAE N ET ANNO NAE SACRAE VRBIS SVA PECVNIA POSVIT.AD. QVARVM DEDICATIO NEM DIEM LVDORVM CVM MISSILIBVS EDIDIT L D D D |
GENIO COLONIAE |
Dans sa publication N° 2174 "Inscriptions romaines de l'Algérie", M. Léon Renier en a donné l'interprétation suivante :
Genio coloniae veneriae Rusicadis Aug(usto) Sacr(um)
M(arcus) Aemilius Ballator,
praeter sestertium d(ecem) m(illia) n(ummum), quae in
opus cultumue theatri
postulante populo dedit,
statuas duas genium
patriae n(ostrae) et Annonae sacrae Urbis,
sua pecunia posuit, ad quarum dedicationem diem ludorum
cum missilibus edidit
L(ocus) D(atus) D(ecreto) D(ecurionum)
Une autre interprétation :
Genio coloniae veneriae Rusicadis Aug(usto) Sacr(um)
M(arcus) Aemilius Ballator,
praeter sestertium d(ecies) m(onetae) novae in
opus cultumue theatri
postulante populo dedit,
statuas duas genium
patriae n(ostrae) et Annonae sacrae Urbis,
sua pecunia posuit, ad quarum dedicationem diem ludorum
cum missilibus edidit
L(ocus) D(atus) D(ecreto) D(ecurionum)
Traduction de la 2ème version - source "L'Institut" N° 63 de Mars 1841.
Au génie de la Colonie de Rusicade consacrée à Vénus,
M. Aemilius Ballator, prêtre d’Auguste et préteur, à la demande du peuple
a donné la somme de dix grands sesterces en monnaie nouvelle
pour les besoins ou l’ornement du théâtre.
Il a (en outre) érigé de ses propres deniers deux statues (représentant)
le génie de notre patrie et la déesse Annona, de Rome,
pour l’inauguration desquelles il a fait célébrer des jeux,
avec accompagnement de largesses.
Emplacement accordé par un décret de décurions.
![]()
La mosaïque de la maison Nobelli, dont le dessin, d'une très belle exécution, représente Amphitrite ou toute autre déesse maritime, entourée de poissons aux couleurs éclatantes.
La maison est dans les parages des citernes du fort d'Orléans et de celle qui sert de fondations à la porte de Stora.
Source : Itinéraire historique et descriptif de l'Algérie - 1862 - p341 (p557)

La propriété Butler, à 1 km de la ville, renferme une fort belle mosaïque décorant le plancher de la salle de bain d'une ancienne villa probablement.
![]()
En 1840, à Stora existaient les magasins généraux de l'administration de l’Annone. Ils mesuraient 75 mètres de façade sur la mer et avaient une profondeur allant de 4 à 15 mètres. Ils consistaient en de nombreuses voûtes très élevées. Une inscription emportée par un Officier et retrouvée au Musée de Toulouse en 1881, rapprochée d'un fragment de pierre du Musée de Philippeville, a permis de déterminer que ces magasins ont été construits sous Vanetinien et Valens par "PUBLIUS CACIONNUS CAECINA ALBINUS, clarissime, consulaire à six faisceaux, de la province de la Numidie Constantinienne, pour la sécurité du peuple romain et des provinciaux."

A Stora, les maisons des pêcheurs sont construites sur les nécropoles romaines, les bâtiments de la Douane, reposent sur les ruines des magasins de l'Annone Sacrée.
Certains immeubles comme celui de M. le Commandant Guillou possèdent encore des caves aux murs d'une épaisseur formidable, et qui constituaient une partie des magasins de l'Annone.
Source : Philippeville et ses environs - Emile Ledermann - 1935

LES CITERNES
Les Romains ont laissé des traces profondes de leur passage et de leur occupation. A 116 mètres au-dessus de la mer, sur la route de Stora à Collo, au ruisseau de la Fontaine ferrugineuse, autrefois l'Oued Chadi (Rivière des Singes) ils avaient capté les eaux et construit une piscine de décantation (piscina Limaria). Deux bassins en contrebas, avec vannes de dégorgement existent encore. La conduite descend pendant 45 mètres et déverse son contenu dans un autre bassin qui reçoit une autre source, puis continu en pente rapide pendant 135 mètres, traverse un tumulus dans un tunnel de 50 mètres qui fut restauré par le génie militaire en 1842 et fonctionne encore. A la sortie du tunnel, la canalisation se dirige vers les citernes toujours en service.
Ces citernes sont des types admirables de la conception romaine en hydraulique. Elles ont 25 mètres de long, 29 de large et 14,50 m de profondeur. L'intérieur est divisé en 6 compartiments communiquant entre eux, et peuvent contenir 3 750 m3 d'eau. L'extérieur restauré, sans aucun goût, par des maçons modernes, ne donne pas l'impression de la beauté intérieure du travail romain.
A 160 mètres de cette grande citerne, à 42 mètres d'altitude, s'en trouve également une autre au milieu du village. Elle mesure 9,15 m de long sur 4,60 m de large et 9 de haut.
La grande citerne devait être en communication avec cette citerne secondaire, mais la canalisation n'en a jamais été retrouvée. Par contre, une canalisation partant de la citerne actuelle, aboutissait à un autre bassin de décantation qui se déversait directement dans une fontaine monumentale dont on remarquera la voûte (8m de large et 9m de haut) où les ménagères viennent faire leur provision d'eau. Jusqu'en 1840, d'autres citernes étaient également visibles mais servirent d'assises aux habitations actuelles.
Stora est donc alimentée en eau potable de la même façon et par les mêmes moyens à peine restaurés que l'antique cité romaine.

Depuis Stora jusqu'à Philippeville les riches citoyens avaient construit de belles et somptueuses villas, et des tombeaux magnifiques.
La plupart des villas modernes ont repris l'emplacement cher aux Romains, tout le long de la côte. Quelques-unes possèdent des vestiges de l'antiquité et en passant le long de la route de la Corniche, on peut en voir dans la propriété Blanchet.
Lorsque les Français arrivèrent à Stora, un officier d'artillerie M. Delamare put prendre quelques croquis de ruines romaines importantes. Depuis tout a disparu. Il suffirait cependant de creuser le sol pour en retrouver les traces.

A Stora, sur le côté gauche de la grande citerne existait un grand cimetière phénicien. Plus à l'Est se trouvait la nécropole romaine. Les maisons actuelles sont bâties sur ces nécropoles qui n'ont pas été sérieusement fouillées.
Non loin de l'établissement de bains et de l'Hôtel Miramar au Ravin du Lion, se trouvait jadis un lazaret pour les navires en provenance suspecte.
Au sommet de la colline, à côté du sentier qui descend sur la plage, existait un petit cimetière de pestiférés, dont on n'a pu sauver qu'une tombe de la destruction des bergers indigènes. Une plaque de grès à fleur de terre, envahie par les touffes de lentisque et de disse sauvage, indique que 3 matelots reposent à cet endroit.
Source : Philippeville et ses environs - Emile Ledermann - 1935

GEN . COL . PVT . AVG . SAC
Gen(io) Col(oniae) Put(eolanorum) Aug(usto) Sac(rum)
Inscription trouvée dans le Théâtre Romain et transportée au Musée du Louvre en 1845.
Inscription reproduite dans l'ouvrage "Archéologie de l'Algérie" de ccc, planche XXV.
M. de Clarac en a commenté l'inscription pages 1315 et 1316 du tome II de son ouvrage "Musée de Sculpture antique et moderne". L'inscription est reproduite dans la planche LXXXV (85) du même ouvrage.
M. Léon Renier a donné cette même inscription, sous le n° 2182 de son recueil des "Inscriptions romaines de l'Algérie".
![]()
"[...] il y a aussi dans le musée d'autres belles choses, comme des stalactites, des coraux, des cristaux trouvés dans les environs, une collection de crânes et même des objets ethnographiques de la Chine.
Mieux encore, M. Roger avait eu la chance de pouvoir acheter pour le musée un authentique Tintoret à un colporteur qui l'avait exposé en plein vent, et ce pour le prix fabuleusement bon marché de 3 francs. Il semble absolument certain que le tableau soit bien du Tintoret et qu'il vaille aujourd'hui quelques centaines de thalers.
La collection de lampes, en particulier, est importante ; quelques unes portent une croix à leur base, signe qu'elles datent de l'époque chrétienne ; lacrymatoires, amphores, urnes funéraires sont là en grand nombre, et l'on en trouve de nouveaux tous les jours.
(A Stora) [...] une immense citerne, [...] ainsi qu'une belle fontaine de marbre située près de la mer et alimentée par la citerne [...]. Surmontée d'une haute voûte, en partie construite en briques, en partie creusée dans le rocher [...]."
Source : Voyages & explorations au Sahara. Tome III – 1868 - 1869
Par Gerhard Rohlfs (Explorateur et linguiste allemand)

Quelques objets provenant du naufrage de la corvette de charge "La Marne", lors d'une violente tempête, le 25 janvier 1841, et en particulier un petit canon, sont conservés au Musée de Philippeville. Par temps clair et mer calme, on aperçoit encore dans le bas-fond de la rade de Stora, ce qui reste du bateau de guerre.
![]()
En 1886, citant un rapport de M. Henri Gouilly, M. Ernest Desjardins donne des informations sur des vestiges découverts lors de la construction de l’église et du square Carnot.
(Note sur la pierre de l'église de Philippeville. In : Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 30e année, N. 2, 1886. pp. 223-227).
« J'ai reçu de l'Académie une communication sur l'inscription commémorative de l'église de Philippeville en Algérie.
C'est un rapport de M. Henri Gouilly, archiviste en chef de Philippeville, contresigné par six témoins : « Le 6 mars 1886, les ouvriers employés du déblaiement de la terrasse supérieure du square en construction sur la place de l'Eglise, mirent à nu une portion de mosaïque posée sur une aire en mortier de 5 cm d'épaisseur. Cette mosaïque était formée de cubes blancs et verts, disposés en losanges blancs et verts. Le dessin était bordé par un encadrement de filets droits, également en marbres de mêmes couleurs. Les dimensions de cette mosaïque étaient de 4 mètres sur 4 mètres. La surface avait perdu son horizontalité et était légèrement ondulée du côté ouest, ce que j'attribue au gonflement des terres du sous-sol.
Il a été impossible de conserver cette mosaïque intacte, le mortier n'ayant plus de consistance. Cependant les cubes de marbre ont été détachés de leur gaine de mortier et conservés pour permettre de rétablir, s'il y a lieu, ce carrelage antique.
Sa position, par rapport à l'église actuelle, était la suivante : à 12,30 m en avant, dans l'axe de la porte de l'église, et à 9 mètres au sud, à partir de ce point, parallèlement à la façade. En profondeur, à 2,95 m, par rapport au niveau de la place avant les déblais.
Cette découverte avait, jusque-là, peu d'importance, sur tout si l'on considère que j'avais déjà rencontré, sur toute la surface du square en construction, une quantité considérable de pierres de taille, les unes en place, les autres renversées, puis des fûts de colonnes et quelques chapiteaux ; le tout indiquait, sans contredit, que je travaillais sur l'emplacement d'un vaste édifice romain.
Le 3 avril suivant, en creusant une fosse pour la plantation d'un arbre, l'ouvrier chargé de ce travail rencontra sous sa pioche une plaque en marbre. Du côté où elle lui est apparue elle ne contenait aucune inscription. M'étant aperçu quelle portait une inscription latine sur la face opposée, je fis déblayer avec précaution les terres autour de la partie qui restait engagée, car un coup de pioche avait brisé la plaque en deux.
J’en fis alors réunir les deux fragments et M. Louis Bertrand, secrétaire de la mairie de Philippeville, put immédiatement constater que cette inscription, restée intacte, était une découverte des plus précieuses au point de vue de l'archéologie chrétienne et de l'histoire de notre ville, car elle témoignait de l'existence, en cet endroit, d'un temple consacré à une martyre. Nous la fîmes transporter avec précaution à la mairie.
La position qu'occupait cet important document archéologique était la suivante : à 13,20 m en avant, dans l'axe de la porte de l'église, et à 19 mètres au sud à, partir de ce point, parallèlement à sa façade. En profondeur, à 3 mètres par rapport au niveau de la place avant les déblais.
Le 9 avril, en creusant les fouilles d'un bassin en avant du mur de front du square, de la place de l'Eglise, les ouvriers mirent à découvert un tombeau renfermant un squelette humain presque entier ou, pour mieux dire, presque complet.
Ce tombeau était situé directement sous la mosaïque découverte primitivement. Il était recouvert de plusieurs larges dalles de schiste de 15 cm d'épaisseur ; ses parois étaient formées de pierres de taille, réunies à la construction elle-même, puis revêtues d'un parement en briques de forme spéciale. Le soi était carrelé en briques, les dimensions de ce tombeau étaient de 2,20 m de longueur, 60 cm de largeur et 50 cm de profondeur. La direction longitudinale était ouest et est.
Le squelette se trouvait dans une position légèrement inclinée ; la tête, regardant l'est, reposait sur une dalle en brique de 3 cm d'épaisseur appuyée elle-même contre une pierre de taille de 50 cm de côté présentant une ouverture circulaire de 21 cm de diamètre.
J'ai recueilli et réuni tous ces ossements pour les soumettre à l'examen de M. le docteur René Ricoux maire de Philippeville, qui s'est chargé de l'étude ostéologique de ces précieux restes.
Outre ce squelette, on a retiré du tombeau quatre clous en fer forgé de 105 mm de longueur et de 1 cm de diamètre à la naissance de la tête. Jusqu'à présent rien ne permet d'expliquer l'existence de ce métal dans le tombeau. Il est impossible d'admettre que les clous aient pu servir à l'ensevelissement ; les dimensions du sarcophage, avec son revêtement en briques, l'absence de tout bois, le diamètre desdits clous, me font supposer, ou qu'ils ont été déposés dans ce tombeau comme offrandes, ou que, peut-être, ils ont servi d'instruments des tortures de la martyre.
Fait et clos à Philippeville, le 14 avril 1886.
L'Architecte en chef de la Ville, Gouilly. »
Ont signé comme témoins des faits relatés ci-dessus : Dr René Ricoux, maire ; Louis Bertrand, secrétaire de la mairie ; Hugues Dry, conservateur du musée ; Augustin Salles, curé de la paroisse ; Edouard Dalmas, architecte ; Alexandre Ponticelli, commissaire de police ; Guillaume Marquet, entrepreneur.
L'inscription doit se lire ainsi. Elle se compose de trois distiques.
MAGNA QVOD ADSVRGVNt SACRIS
FASTIGIA TECTIS
QVAE DEDIT OFFICIIS SOLLICITVDO PIIS
MARTIRISS ECCLESIAM VENERAN
DO NOMINE DIGNAE
NOBILIS ANTISTES PERPETVVs
QVE PATER
NAVIGIVS POSVIT CRISTI LE
GISQVE MINISTER
SVSPICIAN CVNCTI RELIGIONIS OPVS
Magna quod adsurgun[t] sacris fastigia tectis
Quae dedit officiis sollicitudo piis
Martiriss ecclesiam venerando nomine Dignae
Nobilis antistes perpetuu[s] que pater
Navigius posuit, Cristi legisque minister.
Suspiciant cuncti religionis opus.
« Voici que s'élève un imposant édifice fondé par la pieuse sollicitude de la martyre Digna au nom vénérable !
Le noble évêque Navigius, notre père à jamais, ministre du Christ et de la loi, l'a fondée.
Que tous contemplent cet ouvrage de la religion. »